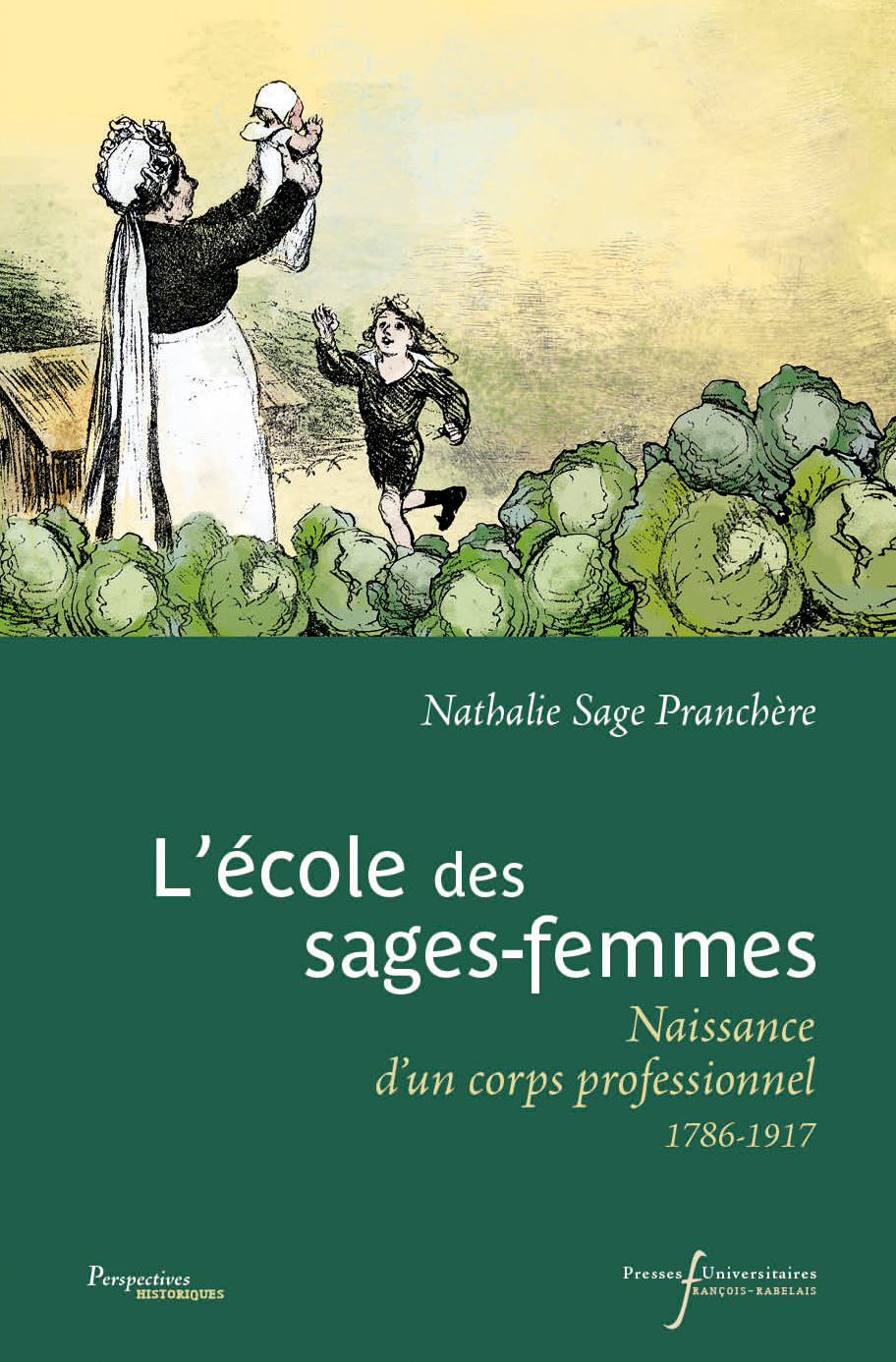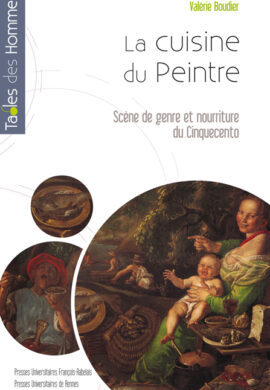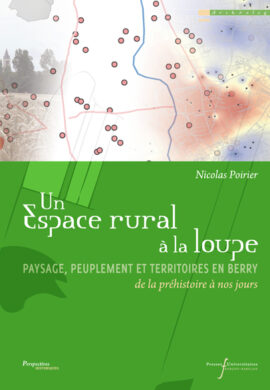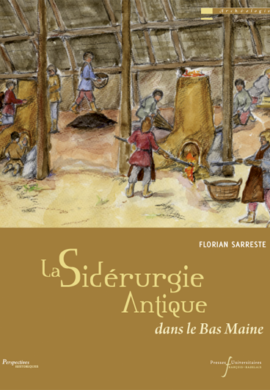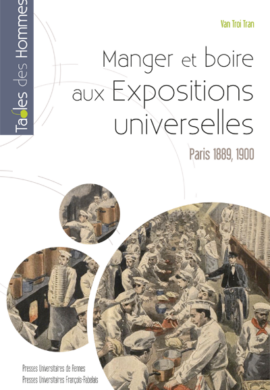Protéger l’homme « au moment où il arrive au port de la vie », telle est la mission que les gouvernements français, de l’Ancien Régime à la IIIe République, assignent aux sages-femmes. Accompagnatrices des mères et désormais membres du corps médical, les sages-femmes se sont constituées au cours du XIXe siècle en profession scientifique, détentrice d’un savoir riche et varié. Partout en France, leur formation a occupé administrateurs et médecins, faisant naître des dizaines d’écoles départementales, dont le dynamisme n’a souvent eu que peu à envier à l’école de l’Hospice de la Maternité de Paris.
Du cours hospitalier à la véritable école-maternité, les institutions de formation ont accueilli en un siècle des dizaines de milliers de jeunes femmes qui, leur diplôme en main, ont été se faire dans les campagnes les « institutrices du système de santé » français.
Lettrées, compétentes et respectées, les sages-femmes ont ainsi fait bénéficier leurs patientes d’une qualité de soins acquise aux meilleures sources du savoir obstétrical. Légitimées par leur formation et le monopole que l’État leur accorde face aux matrones, elles ont mis au monde l’essentiel de la population française, ont vacciné des générations de nouveau-nés et se sont faites les chantres de l’hygiène pasteurienne dès ses débuts. L’histoire de l’émergence de ce corps professionnel, né d’une volonté politique et du consentement des accoucheuses, est riche d’enseignements pour les enjeux contemporains de la naissance et de ses acteurs.
Ils en parlent
Sans l’ombre d’un doute, L’école des sages-femmes est une contribution majeure à l’histoire des sages-femmes et à celle de la naissance. Cet ouvrage a également une valeur incontournable pour qui s’intéresse au genre, à l’histoire de la médecine (obstétrique, enseignement médical), des professions de la santé, de l’éducation et du travail des femmes.
Andrée RIVARD, Recherches féministes, vol. 32, N° 2, 2019, pages 329-333
Outre une analyse historiographique dans l’introduction, l’édition de 2017 présente également une bibliographie complète sur plusieurs décennies de l’histoire des sages-femmes aux XVIIIe, XIXe et premier xxe siècles aussi bien française qu’internationale pour les publications essentielles (2017, p. 405-422). Elle devrait devenir un outil de référence pour toute étude ou article sur le sujet.
Bien au-delà de la seule histoire des sages-femmes, c’est une contribution à l’histoire du travail, à l’histoire de la formation et à l’histoire des femmes qu’on découvre ici.
Béatrice KAMMERER, L’école des sages-femmes, In : Sciences Humaines, n°297 novembre 2017
Par son ouvrage extrêmement documenté, aux sources sans cesse sollicitées, comparées entre elles, et critiquées (« les sources (…) sont des sources publiques (…) [qui] portent un discours et une politique »), Nathalie Sage-Pranchère se livre à une démonstration en bonne et due forme de ce qu’est, au fond, la démarche de l’historien.
Marie RANQUET, Naître ou ne pas naître… en de bonnes mains, In : Nonfiction, publié le 24 avril 2017
«Qui est la sage-femme ?» s’interrogeait, en 2013, un colloque organisé par ces professionnelles de l’accouchement, s’estimant peu reconnues. Cette étude de Nathalie Sage Pranchère, riche d’un impressionnant corpus de sources, répond avec minutie à cette question.
Yannick RIPA, Sage-femme, métier entre deux eaux, In : Libération, publié le 5 avril 2017
S’il leur reste encore des obstacles à surmonter, notamment en termes de reconnaissance, force est de constater que les sages-femmes forment en France une profession de santé à part entière, bien implantée et surtout reconnue par le monde médical et les pouvoirs publics. C’est le résultat d’une construction historique singulière dont Nathalie Sage Pranchère a retracé ici avec brio et précision le déroulement et les arcanes. Elle contribue ainsi à la reconnaissance de ces femmes qui ont consacré leur existence à aider les autres à donner naissance ; mais elle œuvre aussi, et de manière décisive, à l’écriture d’une histoire sociale de la santé soucieuse de mettre en évidence, contre la vielle histoire de la médecine et des médecins, la pluralité des acteurs du soin.
Sommaire
Introduction
Chapitre I : « Il se croit dispensé d’entrer dans aucun détail sur la nécessité d’un cours d’accouchement »
Sur toutes les bouches…
La diffusion du discours
Duplication du discours d’Ancien Régime : une parole captive ?
Trame, fil et navette : le tissage d’un discours
Matrones, sages-femmes, accoucheuses : flou du vocabulaire et sévérité du jugement
Routine et impéritie, aux deux sources du discours dénonciateur
« Dans un pays où tous viennent au monde égaux et libres, chaque naissance est une époque importante »
« C’est d’elles que dépendent souvent la santé et la vie d’un grand nombre d’individus »
La mesure d’une ambition : le choix de la sage-femme
Mésestime ou lucidité ?
Chapitre II : Sages-femmes en Révolution
L’héritage et ses figures
Continuité institutionnelle et projet politique
« Attendons de nos législateurs… »
Pénélope à son ouvrage : les législateurs révolutionnaires
Les cours d’accouchement avant la loi de l’an XI : approche humaine et matérielle
Maintenir, créer, financer : les coulisses des cours d’accouchement
Le fonctionnement des cours
Se porter au-devant des élèves : heurs et malheurs du cours itinérant
Chapitre III : De l’institution à la loi, naissance de la sage-femme française
École exceptionnelle, école unique : l’Hospice de la Maternité de Paris
Et Paris ?
Maintien et invention de la Maternité dans la constellation européenne
Une seule école pour former la sage-femme française : le ministre et le médecin
Des ambitions à la pratique
19 ventôse an XI
Dans le sillage parisien, obstination de la politique ministérielle
L’enseignement obstétrical français à l’épreuve du Grand Empire
La légitimité départementale : résistances locales et appropriation de la loi de ventôse
Paris comme repoussoir
Défense et illustration de l’enseignement obstétrical de province
Chapitre IV : Mailler la France d’écoles
Les cours d’accouchement français au XIXe siècle
L’éclosion des lieux d’enseignement, une évolution non linéaire
Le rayonnement des centres d’enseignement
Les dynamiques interdépartementales
Le fonctionnement des cours : formes et financement
De la tolérance à l’autorisation
Les cadres officiels de la formation publique
Contributeurs et allocations budgétaires
Chapitre V : L’élève sage-femme : un portrait social
« Cet état si méprisable » (Pierre Eyméoud, 1791)
« Tirer les élèves de la classe des pauvres »
D’où viennent les sages-femmes ?
Boursière ou « à ses frais » ? Pouvoir payer son instruction
De la terre à la boutique
Filles et sœurs d’accoucheuses, sages-femmes « par famille » ?
Des mères difficiles à atteindre
Mère-fille, tante-nièce, quelle transmission ?
Sororité professionnelle, une voie à part
Chapitre VI : L’éclosion de l’agent de santé publique
Façonner une nouvelle sage-femme
Un privilège de la jeunesse et du célibat ?
Du plomb en or : l’alchimie du choix de l’élève
L’élaboration d’un modèle d’éducation pour un idéal socio-professionnel
Sage-femme sous le voile
De l’État au département, la sage-femme, agent au service des populations
La sage-femme, une diplômée de l’État
Agent de santé publique
Des élèves départementales pour des sages-femmes départementales
Chapitre VII : Le personnel des écoles d’accouchement
Professer l’art des accouchements : un titre, deux postes
La sage-femme et le professeur : entre exception parisienne et adaptations départementales
Le professorat, enjeu de pouvoir
Compléter le savoir des élèves et tenir la maison
Répétitrices et sous-maîtresses : le ballet des aides
Sous l’autorité des Sœurs…
… et sous l’œil des commissions de surveillance
Chapitre VIII : Savoirs et méthodes
Savoir lire, écrire et accoucher : l’instruction primaire des élèves sages-femmes
Pour la mère, la femme et l’enfant
La science obstétricale : définitions, manuels et ouvrages de référence
Sage-femme, gynécologue, puéricultrice et pédiatre ?
Apprendre et retenir
La répétition au cœur des apprentissages
Passer de la théorie à la pratique
« Au lit des parturientes »
Élargissement du savoir et progrès des soins
L’ancrage de l’obstétrique dans une approche physiologique élargie
Quelle formation « continue » hors du cadre scolaire ?
La révolution pasteurienne ou l’irruption conjointe du microbe et de l’asepsie
Chapitre IX : La résistance d’une profession
De contestations en concurrence, une place à trouver
Réformer la loi de ventôse an XI : bilans et projets du milieu du siècle
Le médicament et l’instrument : aux portes de l’obstétrique complexe
L’usure du système napoléonien
La loi du 30 novembre 1892
Les décrets d’application et la mise en œuvre de la réforme
Le désir permanent de réforme
Le bilan d’un siècle de formation obstétricale
Combien de sages-femmes ?
Première et deuxième classes : vers l’unification du corps
Conclusion
Abréviations
Sources
24,00 €
En stock
L’école des sages-femmes
Protéger l’homme « au moment où il arrive au port de la vie », telle est la mission que les gouvernements français, de l’Ancien Régime à la IIIe République, assignent aux sages-femmes. Accompagnatrices des mères et désormais membres du corps médical, les sages-femmes se sont constituées au cours du XIXe siècle en profession scientifique, détentrice d’un savoir riche et varié. Partout en France, leur formation a occupé administrateurs et médecins, faisant naître des dizaines d’écoles départementales, dont le dynamisme n’a souvent eu que peu à envier à l’école de l’Hospice de la Maternité de Paris.
Du cours hospitalier à la véritable école-maternité, les institutions de formation ont accueilli en un siècle des dizaines de milliers de jeunes femmes qui, leur diplôme en main, ont été se faire dans les campagnes les « institutrices du système de santé » français.
Lettrées, compétentes et respectées, les sages-femmes ont ainsi fait bénéficier leurs patientes d’une qualité de soins acquise aux meilleures sources du savoir obstétrical. Légitimées par leur formation et le monopole que l’État leur accorde face aux matrones, elles ont mis au monde l’essentiel de la population française, ont vacciné des générations de nouveau-nés et se sont faites les chantres de l’hygiène pasteurienne dès ses débuts. L’histoire de l’émergence de ce corps professionnel, né d’une volonté politique et du consentement des accoucheuses, est riche d’enseignements pour les enjeux contemporains de la naissance et de ses acteurs.
Ils en parlent
Sans l’ombre d’un doute, L’école des sages-femmes est une contribution majeure à l’histoire des sages-femmes et à celle de la naissance. Cet ouvrage a également une valeur incontournable pour qui s’intéresse au genre, à l’histoire de la médecine (obstétrique, enseignement médical), des professions de la santé, de l’éducation et du travail des femmes.
Andrée RIVARD, Recherches féministes, vol. 32, N° 2, 2019, pages 329-333
Outre une analyse historiographique dans l’introduction, l’édition de 2017 présente également une bibliographie complète sur plusieurs décennies de l’histoire des sages-femmes aux XVIIIe, XIXe et premier xxe siècles aussi bien française qu’internationale pour les publications essentielles (2017, p. 405-422). Elle devrait devenir un outil de référence pour toute étude ou article sur le sujet.
Bien au-delà de la seule histoire des sages-femmes, c’est une contribution à l’histoire du travail, à l’histoire de la formation et à l’histoire des femmes qu’on découvre ici.
Béatrice KAMMERER, L’école des sages-femmes, In : Sciences Humaines, n°297 novembre 2017
Par son ouvrage extrêmement documenté, aux sources sans cesse sollicitées, comparées entre elles, et critiquées (« les sources (…) sont des sources publiques (…) [qui] portent un discours et une politique »), Nathalie Sage-Pranchère se livre à une démonstration en bonne et due forme de ce qu’est, au fond, la démarche de l’historien.
Marie RANQUET, Naître ou ne pas naître… en de bonnes mains, In : Nonfiction, publié le 24 avril 2017
«Qui est la sage-femme ?» s’interrogeait, en 2013, un colloque organisé par ces professionnelles de l’accouchement, s’estimant peu reconnues. Cette étude de Nathalie Sage Pranchère, riche d’un impressionnant corpus de sources, répond avec minutie à cette question.
Yannick RIPA, Sage-femme, métier entre deux eaux, In : Libération, publié le 5 avril 2017
S’il leur reste encore des obstacles à surmonter, notamment en termes de reconnaissance, force est de constater que les sages-femmes forment en France une profession de santé à part entière, bien implantée et surtout reconnue par le monde médical et les pouvoirs publics. C’est le résultat d’une construction historique singulière dont Nathalie Sage Pranchère a retracé ici avec brio et précision le déroulement et les arcanes. Elle contribue ainsi à la reconnaissance de ces femmes qui ont consacré leur existence à aider les autres à donner naissance ; mais elle œuvre aussi, et de manière décisive, à l’écriture d’une histoire sociale de la santé soucieuse de mettre en évidence, contre la vielle histoire de la médecine et des médecins, la pluralité des acteurs du soin.
Sommaire
Introduction
Chapitre I : « Il se croit dispensé d’entrer dans aucun détail sur la nécessité d’un cours d’accouchement »
Sur toutes les bouches…
La diffusion du discours
Duplication du discours d’Ancien Régime : une parole captive ?
Trame, fil et navette : le tissage d’un discours
Matrones, sages-femmes, accoucheuses : flou du vocabulaire et sévérité du jugement
Routine et impéritie, aux deux sources du discours dénonciateur
« Dans un pays où tous viennent au monde égaux et libres, chaque naissance est une époque importante »
« C’est d’elles que dépendent souvent la santé et la vie d’un grand nombre d’individus »
La mesure d’une ambition : le choix de la sage-femme
Mésestime ou lucidité ?
Chapitre II : Sages-femmes en Révolution
L’héritage et ses figures
Continuité institutionnelle et projet politique
« Attendons de nos législateurs… »
Pénélope à son ouvrage : les législateurs révolutionnaires
Les cours d’accouchement avant la loi de l’an XI : approche humaine et matérielle
Maintenir, créer, financer : les coulisses des cours d’accouchement
Le fonctionnement des cours
Se porter au-devant des élèves : heurs et malheurs du cours itinérant
Chapitre III : De l’institution à la loi, naissance de la sage-femme française
École exceptionnelle, école unique : l’Hospice de la Maternité de Paris
Et Paris ?
Maintien et invention de la Maternité dans la constellation européenne
Une seule école pour former la sage-femme française : le ministre et le médecin
Des ambitions à la pratique
19 ventôse an XI
Dans le sillage parisien, obstination de la politique ministérielle
L’enseignement obstétrical français à l’épreuve du Grand Empire
La légitimité départementale : résistances locales et appropriation de la loi de ventôse
Paris comme repoussoir
Défense et illustration de l’enseignement obstétrical de province
Chapitre IV : Mailler la France d’écoles
Les cours d’accouchement français au XIXe siècle
L’éclosion des lieux d’enseignement, une évolution non linéaire
Le rayonnement des centres d’enseignement
Les dynamiques interdépartementales
Le fonctionnement des cours : formes et financement
De la tolérance à l’autorisation
Les cadres officiels de la formation publique
Contributeurs et allocations budgétaires
Chapitre V : L’élève sage-femme : un portrait social
« Cet état si méprisable » (Pierre Eyméoud, 1791)
« Tirer les élèves de la classe des pauvres »
D’où viennent les sages-femmes ?
Boursière ou « à ses frais » ? Pouvoir payer son instruction
De la terre à la boutique
Filles et sœurs d’accoucheuses, sages-femmes « par famille » ?
Des mères difficiles à atteindre
Mère-fille, tante-nièce, quelle transmission ?
Sororité professionnelle, une voie à part
Chapitre VI : L’éclosion de l’agent de santé publique
Façonner une nouvelle sage-femme
Un privilège de la jeunesse et du célibat ?
Du plomb en or : l’alchimie du choix de l’élève
L’élaboration d’un modèle d’éducation pour un idéal socio-professionnel
Sage-femme sous le voile
De l’État au département, la sage-femme, agent au service des populations
La sage-femme, une diplômée de l’État
Agent de santé publique
Des élèves départementales pour des sages-femmes départementales
Chapitre VII : Le personnel des écoles d’accouchement
Professer l’art des accouchements : un titre, deux postes
La sage-femme et le professeur : entre exception parisienne et adaptations départementales
Le professorat, enjeu de pouvoir
Compléter le savoir des élèves et tenir la maison
Répétitrices et sous-maîtresses : le ballet des aides
Sous l’autorité des Sœurs…
… et sous l’œil des commissions de surveillance
Chapitre VIII : Savoirs et méthodes
Savoir lire, écrire et accoucher : l’instruction primaire des élèves sages-femmes
Pour la mère, la femme et l’enfant
La science obstétricale : définitions, manuels et ouvrages de référence
Sage-femme, gynécologue, puéricultrice et pédiatre ?
Apprendre et retenir
La répétition au cœur des apprentissages
Passer de la théorie à la pratique
« Au lit des parturientes »
Élargissement du savoir et progrès des soins
L’ancrage de l’obstétrique dans une approche physiologique élargie
Quelle formation « continue » hors du cadre scolaire ?
La révolution pasteurienne ou l’irruption conjointe du microbe et de l’asepsie
Chapitre IX : La résistance d’une profession
De contestations en concurrence, une place à trouver
Réformer la loi de ventôse an XI : bilans et projets du milieu du siècle
Le médicament et l’instrument : aux portes de l’obstétrique complexe
L’usure du système napoléonien
La loi du 30 novembre 1892
Les décrets d’application et la mise en œuvre de la réforme
Le désir permanent de réforme
Le bilan d’un siècle de formation obstétricale
Combien de sages-femmes ?
Première et deuxième classes : vers l’unification du corps
Conclusion
Abréviations
Sources
24,00 €
En stock